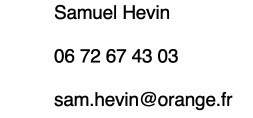Négociations collectives et conditions de travail en CAE
Longtemps expérimentales, les CAE et leurs formes atypiques d’emploi et d’entrepreneuriat ont, depuis la loi de 2014, une reconnaissance juridique et institutionnelle. Cette reconnaissance s’accompagne d’obligations qu’elles ignorent, souvent, ou ont des difficultés de mise en place, telle la représentation du personnel ou la réflexion autour des conditions de travail des salarié·e·s.
La forme instituée du dialogue social, sous la forme du CSE, est devenu obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 11 ETP, depuis les Lois Travail de 2017. Entre les équipes support et les entrepreneur·e·s salarié·e·s, les CAE dépassent très rapidement ce seuil, et devraient bénéficier d’un CSE. Néanmoins, cette mise en place n’est pas sans poser quelques interrogations pour les membres de ces organisations.
Tout d’abord, un manque de connaissance des outils du dialogue social se fait largement sentir, et des possibilités que peut offrir le CSE. Même si les coopérateurs et coopératrices ont conscience des enjeux et de l’importance du dialogue social dans leurs coopératives, iels n’ont pas l’information nécessaire pour prendre en main cet outil qu’est le CSE.
Comment, par exemple, mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans une organisation qui compte quasiment autant de salarié·e·s que de métiers différents ?
Au-delà de l’aspect légal, et des difficultés liées au modèle même des CAE, comment ses membres pourraient-ils mieux s’approprier le dialogue social et le pouvoir d’agir vis-à-vis des normes institutionnelles ? En particulier, comment introduire des notions de qualité de vie et des conditions de travail au sein des CAE ?
Les CAE sont des organisations complexes, qui montrent régulièrement leur détermination à être une alternative dans le milieu de l’entrepreneuriat. Elles peuvent développer un nouveau pouvoir d’agir démocratique sous la forme d’une prise en main des outils du dialogue social. De ce point de vue, l’approche par la négociation collective ne peut qu’être bénéfique, tant au sein de chaque CAE que du point de vue sectoriel national.
La responsabilité légale concernant les risques psychosociaux liés au travail des entrepreneur·e·s salarié·e·s repose sur la CAE.
Comment, par exemple, mettre en place un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans une organisation qui compte quasiment autant de salarié·e·s que de métiers différents ?
Au-delà de l’aspect légal, et des difficultés liées au modèle même des CAE, comment ses membres pourraient-ils mieux s’approprier le dialogue social et le pouvoir d’agir vis-à-vis des normes institutionnelles ? En particulier, comment introduire des notions de qualité de vie et des conditions de travail au sein des CAE ?
Les CAE sont des organisations complexes, qui montrent régulièrement leur détermination à être une alternative dans le milieu de l’entrepreneuriat. Elles peuvent développer un nouveau pouvoir d’agir démocratique sous la forme d’une prise en main des outils du dialogue social. De ce point de vue, l’approche par la négociation collective ne peut qu’être bénéfique, tant au sein de chaque CAE que du point de vue sectoriel national.
La responsabilité légale concernant les risques psychosociaux liés au travail des entrepreneur·e·s salarié·e·s repose sur la CAE.
L’enjeu de ce projet est, dans un premier temps, de faire un état des lieux des connaissances en termes de négociations collectives des membres des CAE, puis de les accompagner dans la concrétisation d’accords d’entreprises. Il sera question de développer leur pouvoir d’agir en les questionnant individuellement et collectivement sur les démarches de QVCT afin d’améliorer les conditions de travail de leur organisation.
Enfin, un autre enjeu sera de réussir à outiller, dans une approche d’autonomisation, toutes les CAE à l’aide de communs mobilisables et appropriables issus du projet.
Enfin, un autre enjeu sera de réussir à outiller, dans une approche d’autonomisation, toutes les CAE à l’aide de communs mobilisables et appropriables issus du projet.
8 CAE composent le panel du projet :
Il semble important de montrer, au sein du panel, non seulement la diversité des champs professionnels que couvrent les CAE, mais aussi les points de convergence des problématiques communes concernant le dialogue social, et en particulier dans le champ des conditions de travail.
Les CAE qui constituent le panel sont conscientes de la nécessité d’un dialogue social concerté et de l’utilisation des outils qu’il dispose. Ces organisations partagent cette volonté de pouvoir mobiliser tous les leviers disponibles du dialogue social et en particulier le processus de négociations collectives afin de concilier qualité de vie et santé au travail et performance de l’organisation.
- Oz, Métiers culturels et créatifs, Pays de la Loire
- Pollen, Ardèche
- CAE 29, groupement de CAE du Finistère
- Co-actions, Gironde
- Consortium Coopérative, domaine de la culture, Poitou-Charente, Dordogne-Gironde
- Cap services, Rhône et Loire
- Ouvre boîtes 44, Loire-Atlantique et Vendée
- Vecteur Activités, Isère
Il semble important de montrer, au sein du panel, non seulement la diversité des champs professionnels que couvrent les CAE, mais aussi les points de convergence des problématiques communes concernant le dialogue social, et en particulier dans le champ des conditions de travail.
Les CAE qui constituent le panel sont conscientes de la nécessité d’un dialogue social concerté et de l’utilisation des outils qu’il dispose. Ces organisations partagent cette volonté de pouvoir mobiliser tous les leviers disponibles du dialogue social et en particulier le processus de négociations collectives afin de concilier qualité de vie et santé au travail et performance de l’organisation.
Samuel Hévin, ancien doctorant en sciences de gestion à l’Université Lumière Lyon 2, au sein du laboratoire Coactis. Il a ainsi travaillé sur “les pratiques coopératives et les organisations alternatives à l’épreuve des normes institutionnelles et réglementaires du dialogue social”. Depuis début 2022, ses travaux de recherche lui ont permis d’identifier les problématiques liées au dialogue social dans les CAE.
Pour ce projet, il accompagnera les CAE du panel et sera garant du bon déroulement de cette recherche-action, qui constituera autant une continuité des travaux déjà réalisés qu’une application de ses hypothèses.
Pour ce projet, il accompagnera les CAE du panel et sera garant du bon déroulement de cette recherche-action, qui constituera autant une continuité des travaux déjà réalisés qu’une application de ses hypothèses.